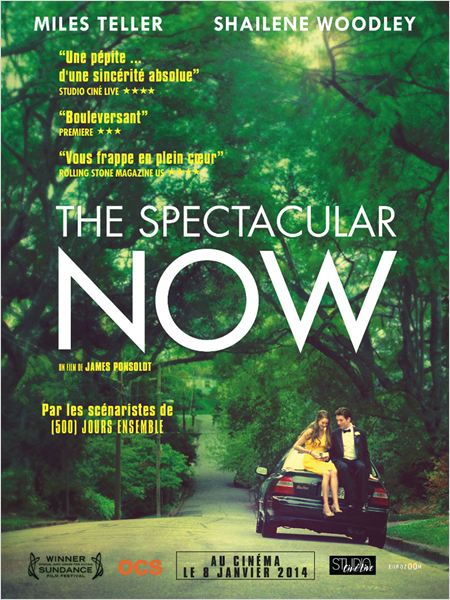Snowden : être ou ne pas être en Amérique…
Nouveau projet du bulldozer écrivain-producteur-scénariste Oliver Stone, connu pour mettre à nu les situations douloureuses de son pays, Snowden partait avec un certain avantage, puisque relevant d’un sujet brûlant, toujours d’actualité. Qui aurait bien pu être sa perte. Explications.
Snowden, comme son nom l’indique, va donc traiter de l’homme derrière le contractuel qui a révélé que la NSA, la toute-puissante agence de renseignement américaine, espionnait citoyens, grandes entreprises, chefs d’Etat. Le film s’attache à décrire le parcours d’Edward Snowden, son patriotisme, son idéalisme, son ascension au sein de la CIA et de la NSA, sa relation avec sa tenace compagne Lindsay Mills, jusqu’à la confirmation qu’il ne pouvait rester sans agir face aux pratiques de son gouvernement.

Oliver Stone n’est pas en terrain inconnu. Scénariste de Midnight Express, réalisateur de Nixon, JFK, Platoon ou encore W, le bonhomme n’en est pas à son coup d’essai quand il s’agit de démystifier les idéalismes que l’Amérique tente de nous faire gober. En l’occurrence, Snowden traite frontalement d’un thème qui revient sinueusement dans les précédents films de son réalisateur : le fameux combat américain pour la « protection » de son peuple, quitte à empiéter sur les libertés fondamentales d’être, d’expression. Snowden, par l’histoire de ce geek surdoué (Joseph Gordon-Levitt, formidable d’authenticité jusque dans la voix), tâche de déconstruire et désacraliser le discours qui voudrait que l’on marche sur les plates-bandes du peuple « pour son bien », alternant avec justesse entre juin 2013 (la rencontre décisive entre Snowden et les journalistes du Guardian) et les années précédentes, qui ont vu l’évolution de sa pensée, tant patriotique (un soldat réformé fier de son pays avant d’y perdre peu à peu foi) que politique (refusant de signer une pétition contre Bush, il finit par espérer la victoire de Barack Obama en 2008). Le film se détache ainsi d’un côté biopic traditionnel, afin d’offrir une mise en abyme intéressante du personnage et creuser ainsi dans les raisons profondes de son action.
Car le film aurait pu vite tourner à court (et à vide). Oliver Stone lui-même l’a reconnu : le problème avec un fait d’actualité tel que les révélations d’Edward Snowden, si peu éloignées dans le temps (2013), et surtout encore en pleine procédure (tout n’a sûrement pas été dit, Snowden est toujours en attente d’un éventuel procès et vit en exil..), c’est que le film aurait pu manquer le coche sur ce qu’il a à dire, faute vraiment de matière non-fluctuante. Et du reste, les révélations en elles-mêmes concernent seulement un quart d’heure, en fin de film : Oliver Stone a rendu l’histoire d’Edward Snowden accessible au grand public, aidé par des acteurs/étoiles montantes (Joseph Gordon-Levitt, une Shailene Woodley à la hauteur, Zachary Quinto impeccable en journaliste déterminé à offrir une porte d’entrée sur la vérité), en tant que nouveau témoignage d’une tare de notre génération technologique et informatique, plus de quarante ans après le scandale du Watergate (déjà immortalisé par Oliver Stone dans Nixon), et dans la lignée de films-chroniques tels que Spotlight, French Connection, Margin Call, ou même Citizenfour, de Laura Poitras (incarnée par Melissa Leo), Oscar du meilleur documentaire et qui traitait déjà de Snowden et de la NSA. La raison profonde d’Edward Snowden est la même que celle de Charlie Sheen dans Platoon, qui est déjà celle d’Oliver Stone lui-même : oui, il faut aimer son pays, les Etats-Unis, le plus grand pays du monde, mais non, cette grandeur ne doit pas se faire au prix de ce pour quoi les Etats-Unis sont devenus indépendants : la liberté. Le film ressuscite à notre époque les thématiques orwelliennes et hobbésiennes du Big Brother, du Léviathan : la surveillance gouvernementale de masse, le pouvoir tentaculaire, et surtout, l’utilisation du progrès à des fins qui dépassent largement la fonction de la justice démocratique à l’américaine (pointée dans le film dans une analogie avec les procès de Nuremberg, accusés « d’exécutionnisme » aveugle).

Cela donne lieu à quelques scènes efficaces, telles que la scène d’amour entre Lindsay Mills et Edward Snowden, où celui-ci est perturbé par la webcam de son ordinateur, point de départ de sa paranoïa de l’observation et de la surveillance ; ou encore celle où il apprend la facilité avec laquelle le gouvernement et les agences de renseignement peuvent se procurer des informations sur n’importe quelle citoyen, la mise en scène amenant toutes les données encodées à former son oeil ébahi. Plus que toute chose, et plutôt que de filmer Snowden en lanceur d’alerte bateau et lambda, Oliver Stone s’est attaché à le décrire comme un mec normal, avec ses névroses (il n’est pas asocial mais plutôt maladroit relationnellement parlant, il est volontaire pour défendre l’idéalisme de son pays mais définitivement inapte à le faire, du moins physiquement, il est épileptique mais ne craint pas le surmenage), un côté froid et calculateur, mais profondément sincère (ce qui donne au film un certain côté manichéen assez dommageable, à commencer par l’intervention finale du vrai Edward Snowden venant délivrer son message) voire enfantin (comme dans sa rencontre avec Hank Forrester, où il reconnaît tous les appareils de la salle). Et dans cette façon de lui tirer le portrait, Oliver Stone se fend de séquences et d’explications en apparence comiques, mais intrinsèquement terrifiantes : comment lui, qui n’est qu’un homme malgré ses qualités, peut, sous couvert de servir son pays, avoir tant de pouvoir, dont celui, littéralement, de vie ou de mort sur les gens (on voit des drones tuer des enfants sans sourciller grâce aux renseignements). Plusieurs scènes concrétisent ce vertige : celle où Gabriel, un autre employé de la NSA, lui explique comment fonctionne les logiciels de renseignement tels que PRISM ou XKeyscore, et avec quelle aisance on peut ficher les gens selon leur degré de dangerosité : c’est cette aisance, cette faculté du virtuel à briser toutes les frontières, même les plus intimes, qui est bien restituée dans ce film, et en tant qu’on peut facilement pénétrer ces endroits intimes. C’est là qu’intervient une autre scène marquante, celle où Snowden se retrouve en vidéoconférence face à son mentor Corbin O’Brian, qui l’avertit de ne pas toucher à des logiciels pour lesquels il n’est pas habilité afin d’assouvir ses propres fantasmes… avant de lui déclarer, la tête grossie par la caméra, que sa copine ne le trompe pas avec un de ses amis. Critique du cynisme absolu à l’intérieur des hautes sphères américaines, le film dépeint ici directement le fameux « Big Brother is watching you ».
La relation avec sa compagne est d’ailleurs un prisme essentiel pour comprendre la descente aux enfers patriotique d’Edward Snowden, qui l’ont conduit, comme il le dit lui-même, à troquer sa vie de famille, confortable, bien payée, avec celle de fugitif exilé de son pays et réfugié chez l’ennemi héréditaire des Etats-Unis, la Russie. Dans cette ébauche de guerre froide qu’il a créée sans remords, l’attache qu’il retrouve toujours au sein du monde réel est sa compagne, Lindsay Mills, qui le suit partout, le comprend toujours, et lui pardonne éternellement. Plus encore que d’en faire « simplement » un homme à principes, Oliver Stone fait d’Edward Snowden une figure universelle, suffisamment douée pour partager ses connaissances innées avec un monde qui ne sait pas forcément quelles sont les siennes et qu’il encourage à découvrir et à faire ce qui est juste. D’où ici la force de sa relation avec Lindsay Mills, qui à Tokyo lui reproche d’être devenu un robot sans coeur et sans affection, qui ne lui parle ni ne la touche plus, cela conduisant à leur première rupture ; ou qui accepte de le suivre à Hawaï si cela peut aider à ce qu’il aille mieux. C’est d’ailleurs aussi pour elle, en partie, qu’il démissionne une première fois de la CIA : puis, quand il apprend qu’elle est surveillée, qu’il décide d’agir. Lindsay Mills est le facteur X de l’évolution de son rapport à son travail et à son pays, celui qui, malgré tout le bonheur qu’il procure, l’amène toujours à se questionner sur la justesse de ce qu’il fait. C’est ce côté relationnel entre Snowden et le monde, son entourage, qui donne au film, en sous-main, sa force : à l’image d’un Margin Call, précédemment cité, sa puissance vient du côté « Lorenzaccio » de son propos et de sa représentation : le dévoilement de « l’affreuse nudité » de l’humanité, plus percutant qu’une image choc.
Intéressant dans son travail de procédure, fouillé dans sa recherche documentaire pour offrir le film le plus accessible possible, Snowden n’est peut-être pas le film le plus punchy de la carrière d’Oliver Stone, mais méritera d’être remémoré dans l’histoire des grandes fresques de l’Amérique.